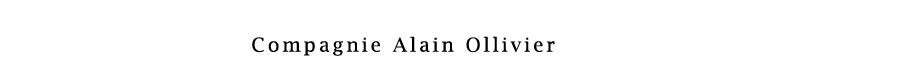Alain Ollivier. Auditorium du Louvre, Paris.
25 mai 2009. Photo©Céline Huet(DR)
Hommage à Alain Ollivier
Philippe Adrien
Église Saint-Roch, paroisse des artistes, vendredi 28 mai 2010
« Aujourd’hui, Alain a ouvert les yeux, il a vu son frère Yann, et lui a demandé par quel TGV il était arrivé, puis il nous a dit en regardant vers la fenêtre : “il fait beau”.
Et je lui ai offert un peu de cette magnifique journée de printemps en ouvrant grande la porte-fenêtre de sa chambre et les persiennes… Je lui ai dit de bien regarder le soleil, les arbres en fleurs, le ciel azuré, et il a souri. »
Ces lignes sont extraites d’un courrier que m’a adressé Claire Amchin il y a quelques jours.
Nous sommes réunis ce matin pour faire l’hommage de notre amitié à Alain Ollivier.
C’est Daisy Amias qui un jour m’a parlé d’Alain alors que j’étais occupé à réunir des comédiens pour jouer Ubu Roi et aussi Ubu Cocu, la pièce bourgeoise que je voulais enchâsser dans la farce épique. J’ai dû commencer par dire à Alain que je n’avais pas grand chose à lui proposer, sinon le Roi de Pologne, le Czar et, en cherchant bien, la sorte d’apparition vengeresse concoctée gaillardement par le jeune Alfred Jarry et ses condisciples du Lycée de Rennes… Oui, l’apparition du très fameux Mathias Von Königsberg, soit quelques phrases proférées censément depuis l’au-delà !... Proposition qui me paraissait globalement bien mince pour un comédien, qui déjà quelques années auparavant avait obtenu le prix de la Critique Dramatique.
Eh bien, Alain Ollivier adhéra aussitôt à ce plan. Je me demande encore aujourd’hui ce qui a bien pu le convaincre, voire le captiver dans cette aventure… Faute d’une quelconque réponse rationnelle, je dirais que c’est probablement le fait d’avoir à interpréter dans la même soirée deux rois – dont l’ombre de Mathias, fondateur de la lignée royale de Pologne - plus un empereur, le Czar de Russie, oui, je pense que c’est précisément cette énorme charge symbolique conjuguée à l’absurdité de la Geste Potachique - Ubu, n’est-ce pas, ce que ça représente comme extrême dérision - oui, je crois que c’est cela, ce contraste, qui a convaincu Alain de me suivre. Comme s’il y avait eu en lui un pataphysicien natif, qui cette fois au moins devait paraître en scène, ou plus exactement sur la piste du cirque de Reims que nous avions pour la circonstance réhabilité.
Nous sommes là dans le champ de ma mémoire initiale… Une de nos premières répétitions…
À vif !... C’était ma manière de cette époque, foin de travail à la table, nous débitions à toute allure, « en impro », les scènes brèves qui démarrent la pièce… Tandis que le père UBU combinait l’avenir avec sa mégère de femme, j’aperçois Alain dans un coin, occupé à démonter une vieille chaise. Le dossier fait de barreaux était en effet susceptible de fournir une bonne prise à la main. Je lui demande ce qu’il fabrique, sa réponse : « Je me bricole un bouclier pour la guerre ». Idem pour le sceptre du Czar, confectionné par lui-même en torsadant le couvercle d’une boîte de conserves. La flexibilité de cet accessoire appliqué à petits coups secs sur le casque d’Ubu se révéla une arme au pouvoir comique irrésistible.
Oui, j’eus donc cette chance de découvrir d’emblée chez Alain Ollivier, une fantaisie, une légèreté qui chaque fois que nous nous sommes retrouvés au fil des années, nous menait à rire ensemble. J’appréciais son humour, et surtout son goût de la langue, la langue qui se parle - on sait qu’elle nous vient de nos grands-parents pour ne pas dire de nos aïeux, avec de savoureux effets de gouaille à l’ancienne - et chez Alain, des tonalités que je dirais, curieusement, « militaires », oui, chez cet anti-militariste résolu. Je me rappelle encore d’expressions qui lui étaient familières, comme, par exemple, pour qualifier tel individu trop plein de certitudes ou de prétentions, il lançait : « Ce gars-là, c’est le chou-fleur ! »
Alain était d’abord un comédien :
la grâce singulière de son expression, de sa présence, de son tempérament animait la vitalité d’un jeu virtuose et tout en ruptures.
Formé en 1960 à l’École Charles Dullin par Georges Wilson et surtout peut-être par Alain Cuny
- son dire en était quelquefois marqué –
quoique attiré par la mise en scène et très vite repéré à ce titre, Alain Ollivier ne cessa jamais de jouer, de s’offrir et s’abandonner à ce désir originel, son désir d’interprète.
Il le fit comme pour vérifier, d’expérience, ce qui se passe en scène pour le comédien : ce qui se passe et ce qui passe du Texte au Corps.
Il se référait volontiers à Jouvet : « Au théâtre, tout est suspect sauf le corps ». Alain prêtait foi à cette démarche, à cette mystique, songeant bien sûr aussi à Antonin Artaud dont il retenait la posture de l’athlète affectif. Il était en quête d’une Vérité profonde qui excèderait l’apparence et le semblant. Une recherche si fondamentale à ses yeux qu’il lui fallut pour la mener à terme, passer de l’autre côté, diriger des acteurs et donc mettre en scène.
Il conduit une première expérience en 1967 avec La Poudre d’intelligence de Kateb Yacine. Spectacle qui lui valut alors le prix des jeunes compagnies de la ville d’Arras.
En 1973, il remet sur le métier ses questions avec Pierre Guyotat, son double en poète.
Et ce fut Bond en avant.
Les deux spectacles, à six ans d’intervalle, sont évidemment liés, ils ont en commun la guerre d’Algérie dont la violence, l’injustice, l’indignité frappent Alain de plein fouet durant la période qu’il passe à Constantine de 54 à 58.
Écoutons le :
« Au sortir de l’adolescence, ce que j’ai vu dans les rues, conséquences d’une authentique révolution, d’une guerre totale n’épargnant ni civils, ni militaires, ni villes ni campagnes, m’en a plus appris sur l’histoire et la politique que la seule lecture fût-elle studieuse de mes livres de lycéen…
Rafles, cris et sanglots d’enfants terrorisés par les perquisitions armées.
La place de la Brèche à Constantine, remplie d’hommes debout, tassés les uns contre les autres, les mains en l’air…
Chasse à l’homme au couvre-feu…
Aux enterrements civils et militaires, désespoir des femmes, fureur des hommes et cris de haine contre la République…
Enfant hurlant traîné sur le bitume, sous le ventre de la moto d’un soldat affolé… Choc sourd d’une tête frappée à coups de pieds contre la bordure du trottoir, sous la fenêtre de ma chambre, la nuit…
Homme sur l’asphalte dans son sang séché au soleil, la tête dans un essaim de mouches, abattu là au hasard et pour l’exemple, sous la garde de sentinelles angoissées…
Ventre déchiqueté et palpitant d’un petit cireur piétiné par la foule en fuite, à l’explosion d’une bombe…
Ce que je peux comprendre de l’Histoire, j’ai commencé à le comprendre là dans les rues de Constantine, dans les cris, les larmes, le sang et l’effroi ».
Sans doute, le caractère fraternel de la rencontre d’Alain Ollivier avec Kateb Yacine, a-t-il contribué à atténuer en lui « la honte nationale » que dit-il « tout citoyen éprouve devant les crimes de sa patrie ». Mais il lui fallait y revenir et tenter, je crois, d’exorciser son épouvante d’adolescent. Dès la fin des années 60, il trouve chez Pierre Guyotat, dans Tombeau pour 500 000 soldats ou Eden, Eden, Eden, une matière qui certainement ravive ses blessures, ses plaies, mais qui aussi lui offre la chance d’une purgation, comme par excès, du traumatisme de la guerre d’Algérie.
Pardonnez-moi si je prends le risque de cette approche qu’Alain lui-même, peut-être, eût récusée, c’est que l’homme me semble, sa vie durant, avoir été essentiellement animé par un idéal de justice et de compassion. Je pense que tout commence là.
Oui, Alain Ollivier citait Jouvet : « Au théâtre tout est suspect sauf le corps », à quoi il ajoutait : « c’est une des pensées que je préfère et à laquelle je pense souvent car elle invite au silence, donc à apprendre l’usage de l’oreille, qui est bien plus précieux pour jouer et mettre en scène que tout ce qu’on peut en dire ou écrire ».
Cette réflexion sur le silence, cette pensée du silence, n’interviendra que plus tard, au temps de la maturité. Avec Bond en avant, ce qui domine, à l’évidence, est un cri sans fin - la compacité du texte en témoigne - un cri dont l’articulation complexe et le vocabulaire torturé, excède tout aspect de sens et nous fait éprouver de l’intérieur le désastre de la guerre: un chaos. Un chaos qui aussi n’est pas sans rappeler l’épisode fondateur pour chaque petit enfant de l’apprentissage de la langue que nous appelons « maternelle ».
Bond en avant, c’est d’abord un texte. Un texte dont la mise en bouche représente à elle seule une prouesse…
Jacques Derlon qui dirigeait alors le Théâtre de La Tempête me rappelait hier que l’événement scénique tenait aussi à une série d’actions concrètes tout à fait impressionnantes : chariotage, déballage et manipulation de peaux et de carcasses d’animaux sanguinolentes qu’Alain et son complice François Kuki allaient chercher chaque matin aux abattoirs pour les rapporter à la Cartoucherie…
La mise en scène de ce texte, dans laquelle Alain s’engage de manière intellectuelle mais aussi physique, disons même organique, constitue évidemment l’acte fondateur de son projet théâtral, de son théâtre. Il en est bouleversé.
« Au lendemain des représentations de Bond en avant, j’étais dans un grand désarroi. Jamais, je n’avais à ce point éprouvé la sensation d’accomplissement que procure le travail, celui de puiser dans l’inconnu de ses ressources, jamais je n’avais eu un sentiment aussi net de la vie de l’art, jamais non plus avant d’entrer en scène je n’avais éprouvé – bien plus que le trac – la peur.
Ce n’était pas la peur de commettre une erreur de texte, cela je savais que c’était improbable, c’était la peur d’entrer dans un Temps qui n’était pas celui de mon présent, la peur et sans doute même la terreur d’entrer de mon vivant dans un autre Temps que celui de mon vécu. Un Temps que mon imagination n’avait jamais pu entrevoir comme possible… ».
Alain, c’est probable, n’avait à cette époque aucune idée du Marin de Pessoa qu’il mettra en scène beaucoup plus tard, en 2006. On éprouve cependant l’étrange impression que Le marin fait écho à ce témoignage de l’acteur de Bond en avant, que cette peur de basculer dans un autre Temps, cette autre vie qui s’ouvre dans le temps de la représentation et menace de prendre le pas sur le vécu de l’interprète, cette métamorphose est comparable à ce qui arrive aux veilleuses du Marin lorsque le jour se lève…
On entend la voix de la deuxième veilleuse :
Peut-être que rien de tout cela n’est vrai… Tout ce silence et cette morte, et ce jour qui commence, tout cela n’est peut-être qu’un rêve. Regardez bien autour de vous. Vous semble-t-il que tout cela appartienne à la vie ? Il est si étrange de se trouver là, en train de vivre… Tout ce qui arrive est incroyable, sur l’île du marin comme dans ce monde… Voyez, le ciel est vert déjà… L’horizon sourit de l’or… Pourquoi le marin ne serait-il pas la seule chose vraie dans tout ça et nous, tout le reste avec nous, un simple rêve qu’il ferait lui ?
La première veilleuse l’interrompt :
Ne dites plus rien ! Cela est si étrange que cela doit être vrai… Ne continuez pas… Je ne sais ce que vous alliez dire, mais cela doit être plus que l’âme ne peut entendre…
Pour Alain aussi, le temps est venu du silence et de l’apaisement…
Se taire, écouter, et qui sait, peut-être entendre l’inouï…
L’inouï du silence…
On l’interroge cependant encore une fois :
-- Avant de nous quitter, êtes-vous certain de n’avoir rien à dire de plus à propos du secret ?
-- Oui…
Parce qu’aujourd’hui, où souvent j’éprouve être comme le survivant ou le somnambule de ma vie,
ou les deux à la fois,
j’ai aussi la sensation d’être tenu par un secret dont j’ignore de quoi il est fait.
C’est que l’objet du désir reste obscur.
Je suis comme l’enfant qui demande à son père : « à quoi ça sert la vie ? »
Pour moi, la vie n’a de sens que si elle sert à quelque chose qui touche à la beauté du monde – laquelle n’est pas accessible sans cette respiration qu’on nomme la foi…
Rappelons nous aussi :
L’échange,
Partage de midi,
Les Bonnes,
Ange Noir,
La Révolte,
Les Nègres,
Pelléas et Mélisande…
… La beauté et la lumière du Cid…
… Se rappeler le courage, la lucidité, l’engagement, l’exigence et la probité de cet homme si ardemment convaincu de la nécessité de maintenir un théâtre public digne de ce nom, dans notre pays.
… Et enfin, la joie, la joie qu’Alain savait si éminemment transmettre aux comédiens…
Sa ferveur…
Sa bonté…
Le reste, oui, est silence…
Philippe Adrien
Église Saint-Roch, paroisse des artistes, vendredi 28 mai 2010